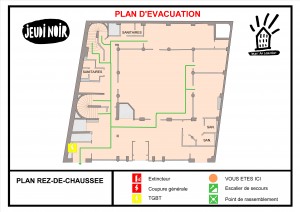Ce billet est la suite de celui-ci
Mardi.
Dès neuf heures du matin, les militants qui le peuvent nous rejoignent à l’intérieur. On commence à multiplier les entrées et sorties, mais nous restons dissimulés dans l’arrière du bâtiment. Vers dix heures, on envoie un communiqué de presse qui donne rendez-vous au métro Bourse, mais sans préciser l’adresse. A onze heures, enfin, on annonce l’adresse aux médias, les premiers élus arrivent et nous déployons les banderoles en façade. Les commerçants de la rue commencent à se rendre compte qu’il se passe quelque chose. Comme on est sorti devant la porte pour accueillir les arrivants, le patron de l’agence immobilière en face vient nous voir. Il nous demande le but de notre occupation, on le rassure en lui disant que ce sera un immeuble d’habitation. Il n’y aura pas de concert avec des centaines de personnes buvant et fumant dans la rue… Il en profite pour nous confirmer que l’immeuble est vide depuis des années, et qu’il trouve cela scandaleux qu’il ne soit pas loué. C’est vrai que, pour les affaires, ce serait préférable.
Pendant que les élus du front de gauche et d’europe écologie les verts discutent avec les journalistes, quelques socialistes nous annoncent leurs venues pour l’après-midi. Le maire de l’arrondissement vient nous apporter son soutien. A la porte, on s’étonne de l’absence de réaction de la police : lors de notre dernière tentative, une semaine avant le premier tour des présidentielles, les compagnies d’intervention avaient mis six minutes chrono après le communiqué de presse pour venir bloquer les accès. C’est notre petit bonhomme de la Direction des Renseignements de la Préfecture de Police (DRPP) qui arrive le premier et nous pose les questions habituelles avec son accent chantant : « Depuis quand êtes-vous installés, combien êtes-vous, est-ce que TF1 est là ? » Comme on avait prévu de manifester devant le sénat pour le début de l’examen du projet de loi sur le logement, la police nous attendait là-bas. C’est vrai que nous ne les avons pas prévenu de ce changement dans notre agenda. Il nous affirme qu’en tous les cas, il n’y aura pas de blocus comme il y en avait eu avenue Matignon. C’est vrai que Nicolas Sarkozy n’avait pas apprécié qu’on ait une vue directe sur ses appartements privés de l’Elysée. Lorsque deux civils du commissariat de quartier arrivent, nous faisons les présentations. Nous présentons la preuve de notre présence, dans une ambiance détendue. Lorsque le commissaire de l’arrondissement arrive, nous plaisantons avec lui, il sait bien que, s’agissant du DAL et de Jeudi Noir, il sera dessaisi au profit de la Direction de l’Ordre Public et de la Circulation (DOPC) à la Préfecture de Police (PP). Il n’aura aucune décision à prendre, à peine sera-t-il informé des évènements.
Comme le nombre de policiers augmente lentement, et que ceux-ci ne bloquent pas les accès du bâtiment, bon nombre de militants vont chercher de quoi se sustenter. Les pates à l’eau du sous-marin, ça commence à bien faire, et de toute façon, il n’y en a plus. Profitant de ce qu’on ne surveille pas la porte, un individu entre à grand pas dans le hall, sans dire un mot aux militants. C’est un « en bourgeois » en sweat à capuche, qu’on arrête au rez-de-chaussée. Quand nous lui demandons calmement de sortir, il a le culot de nous reprocher notre manque de politesse.
L’AFP nous prévient qu’Allianz n’est finalement pas le propriétaire du bâtiment, mais n’était que le locataire. Ils ont quitté les lieux depuis plusieurs années déjà. D’autres sources, que nous pouvons interroger maintenant que l’adresse est connue, nous disent que les réels propriétaires sont deux caisses de retraites.
Deux gradés de la PP arrivent, que nous surnommons « Feuille de Laurier » et « Feuille de Chêne », d’après leurs képis. Feuilles de Chêne demande à voir la commande de la ligne Internet, que nous présentons à nouveau, puis décide que finalement, il nous faut un constat d’huissier. Il sait pourtant très bien que, depuis le constat d’occupation de l’avenue Matignon, les huissiers ont eu des ordres de ne plus faire de constat pour des squatteurs…
On sent que la situation se dégrade peu à peu. Les tractations ne se font plus au niveau de la préfecture de police, mais directement dans les cabinets des ministères. Signe inquiétant, les quelques socialistes qui avaient prévu leurs visites se trouvent subitement des réunions importantes. En effet, quelques instants plus tard, les véhicules de la 12ème compagnie d’intervention de la DOPC s’arrêtent devant le bâtiment, et les hommes bloquent toutes les entrées dans le bâtiment. Les nouveaux et les journalistes ne comprennent pas encore très bien, mais pour nous c’est l’évidence, l’expulsion est quasi inéluctable. Pourtant, d’autres squats ont ouvert avec bien moins de preuve que les nôtres… Petit à petit, les personnes qui étaient parties pour se nourrir reviennent et doivent rester à la rue, notamment une des mères de famille. Elles sont même rapidement chassé de devant la façade, où nous pouvions discuter avec elles, pour être positionnées à un carrefour des environs. Après négociation, la police nous autorise un peu de nourriture. Il était temps, nous n’avions plus qu’un peu de pain de mie pour les enfants. Là encore, les vidéos de bottes de carottes essayant de passer par dessus les boucliers des CRS ont dû être un mauvais souvenir de la police. Comme ils ne veulent tout de même pas autoriser des militants à se rendre devant l’immeuble, ce sont les policiers eux-mêmes qui font les navettes. Dans le même temps, un poste de commandement est installé dans une boutique en face de l’immeuble. Feuille de chêne et Feuille de laurier y font des aller-retours, vissés au téléphone.
Nous aussi, nous l’utilisons, et les militants du coin de la rue nous donnent des nouvelles des renforts. A l’est, la gendarmerie mobile, cinquième escadron, deuxième groupement, première légion, vient d’arriver. Le panier à salade aussi, avec les autres véhicules de la 12ème compagnie, qui se tiennent hors de notre vue à l’ouest, dans une voie perpendiculaire. Bientôt, les moblots viennent remplacer les compagnies d’interventions.
Nous avons fermé la porte d’entrée à double tour lors de l’arrivée de tous ces gens, mais Feuille de Chêne veut absolument une démonstration de nos clefs. Il éloigne un peu ses troupes de la porte, et on le fait entrer dans le sas pour lui montrer de l’intérieur que oui, nous pouvons bien fermer et ouvrir. Des journalistes, qui commencent à trouver le temps long, en profitent pour sortir. Quelques instants plus tard, alors qu’une deuxième équipe souhaite sortir, les forces de l’ordre en profitent pour enfoncer la porte et investir ce sas. Pourtant, ils n’ont pas encore l’ordre d’intervenir, puisqu’ils ne franchissent pas la deuxième porte, et ne pénètrent pas plus avant dans le bâtiment.
Un petit détachement de la Force d’Intervention de la Police Nationale, la brigade anti-commando, passe devant le bâtiment, harnaché de toute part. Passant par les immeubles voisins, ils viennent prendre position sur notre toit. Depuis une fenêtre du dernier étage, nous échangeons quelques coucous. Ils veulent nous empêcher de s’y réfugier : lors d’une autre expulsion, un individu a passé plus de six heures en équilibre sur une corniche d’un deuxième étage, forçant l’intervention des pompiers. Le négociateur du GIGN a été surpris que sa demande soit simplement de pouvoir récupérer ses affaires, qui autrement auraient été jetées. Cependant, nous ne sommes pas là pour mettre des vies en danger. Sur un toit en pente, sur du zinc humide, on refuse de prendre des risques.
Derrière la baie vitrée du rez-de-chaussée, on observe le matériel déployé : pinces coupantes de plus d’un mètre d’envergure, béliers, marteaux, pieds de biches… Eux n’ont pas à se préoccuper des effractions ou dégradations, ils sont couverts. Sur le trottoir devant la porte, une chaine les gênerait pour nous transporter ; elle est sciée promptement.
Pour autant, la diplomatie ne ménage pas ses efforts : en pleine séance d’examen de la loi sur la mobilisation en faveur du logement, un sénateur évoque notre situation. Le cabinet du ministère du logement nous fait savoir qu’il a officiellement demandé à son homologue de l’intérieur que nous ne soyons pas expulsé. Après coup, Cécile Duflot jugera « incompréhensible » notre éviction. C’est peut-être son poids réel au sein du gouvernement, qu’elle n’a pas bien compris.
Néanmoins, son intervention nous permet de « négocier ». Avec la police sur le toit, les gendarmes dans le sas du bâtiment, le directeur adjoint du cabinet de la Préfecture de Police nous appelle à la fenêtre. Nous montrons, une nouvelle fois, notre commande internet, mais elle est évacuée d’un revers de main : on nous explique qu’il faudrait qu’ils fassent des vérifications pour savoir si nous avons réellement passé cette commande, si nous ne leur présentons pas un faux. Ils n’ont pas le temps, il faut expulser avant. L’histoire, la vraie, celle des vainqueurs, c’est que nous sommes entrés ce matin. Pour justifier l’intervention de la police, on nous reproche une infraction. Laquelle ? Pas de réponse, nous n’avons pas à savoir.
Dans le même temps, la police nous garantit qu’il n’y aura pas de garde à vue, pas de contrôle d’identité. Pourtant, il paraît que ce sont des choses qui se font, lorsqu’on arrête des gens en flagrant délit ! La discussion tourne court assez rapidement : on ne va pas résister, ça ne servirait à rien, mais de là à ouvrir la porte et sortir volontairement… La fenêtre se ferme. Officiellement, notre négociateur va en référer à sa hiérarchie. En pratique, tout le monde sait depuis longtemps que la décision a déjà été prise.
A l’intérieur, nous ne sommes plus qu’une grosse vingtaine, dont quatre enfants. Les matelas ont été descendus dans le hall, les affaires regroupées. Ne restent plus que les banderoles en façades. En plus de mes affaires personnelles, je m’occupe de celles des militants qui étaient sortis acheter à manger et n’ont pu rentrer. Ils sont toujours privés de leurs papiers, de leurs lunettes… On se regroupe au rez-de-chaussée, en arc de cercle dans le hall. Les enfants sentent la nervosité ambiante et se tiennent sages. Seul le plus petit s’agite dans sa poussette. Enfin, les opérations sont déclenchées. A travers la verrière, nous voyons la brigade anti-commando descendre la façade en rappel entre le cinquième et troisième étage, pour prendre position sur le dernier élément de toiture qui échappait à leur contrôle. En bas, un simple coup de masse a fait exploser la serrure qui fermait la porte intérieure du sas. Casqués, avec leurs boucliers transparents, les gendarmes mobiles investissent le bâtiment. Pendant plusieurs minutes, nous nous regardons en chien de faïence : un peloton doit vérifier qu’il ne reste personne dans les étages avant de procéder à l’extraction proprement dite. Seuls un gendarme et un militant tournent autour de nous pour filmer mutuellement la scène. Enfin, un deuxième peloton vient prendre position derrière nous : nous sommes complètement encerclés. Posant leurs boucliers, ils s’approchent d’une extrémité de notre ligne pour soulever les habitants. Les enfants se mettent à pleurer. Soulevé à mon tour, je refuse de marcher puis me ravise en passant devant la poussette. Seul moment cocasse, avant de passer la porte, les deux gendarmes qui me tiennent fermement se rendent compte que nous ne passerons pas à trois de front. Il faut bien quelques secondes pour que l’un se décide à me lâcher le bras. Dehors, je suis rapidement propulsé derrière la rangée qui protège la zone d’opération, et me retrouve au milieu des militants venus nous soutenir.
Quelques minutes suffisent pour sortir les habitants restant. On sent que la police n’est pas trop sûre d’elle-même, sur la légalité de cette expulsion. Nos matelas nous sont rendus immédiatement, des hébergements sont trouvés pour les familles sans abris. C’est assez inhabituel pour être signalé. Nos menaces implicites de poursuites judiciaires auraient-elles fait peur ?
 L’édition du jour du Parisien nous apprend que le Parti communiste a demandé (et obtenu !) l’expulsion de squatteurs d’un immeuble au 149, rue du château dans le 14ème arrondissement.
L’édition du jour du Parisien nous apprend que le Parti communiste a demandé (et obtenu !) l’expulsion de squatteurs d’un immeuble au 149, rue du château dans le 14ème arrondissement.